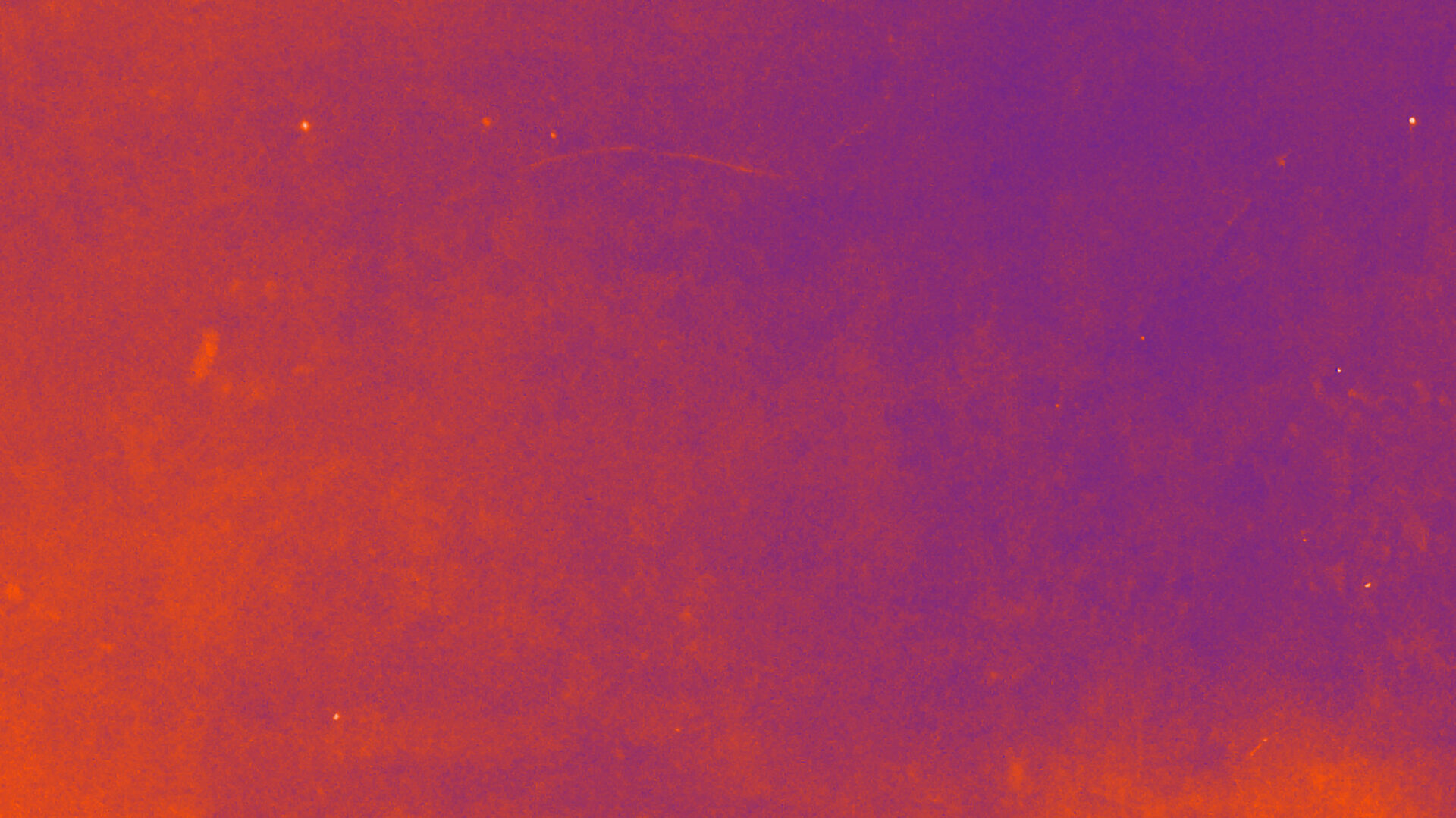Les intervenant·es
et l’équipe de l’édition 2024

Ange Pottin est docteur en philosophie de l’ENS de Paris et travaille à l’intersection de la philosophie des sciences et des techniques et des Science and Technology Studies. Après sa thèse, qui consistait en une généalogie historique et philosophique du “cycle du combustible nucléaire fermé” en France, son parcours de “post-doc” l’a amené en Europe centrale : d’abord à Prague (Centre Français de recherches en sciences sociales), puis à Vienne (Département de Science And Technology Studies, projet “INNORES”), où il continue à travailler sur l’héritage résiduel de l’industrie nucléaire. Il a notamment publié Le nucléaire imaginé. Le rêve du capitalisme sans la Terre (La Découverte, 2024).

EAAPES est un groupe de recherche sur les questions féministes et de genre dans la science-fiction. Clara Pacotte et Charlotte Houette l’ont créé en 2017 au sein de The Cheapest University. EAAPES a vocation à rendre accessible en français des textes encore jamais traduits (essais, fictions, interviews, tables rondes, archives). Leur travail a été présenté par exemple à Yale Union, à la Paris Ass book Fair, au CAC Bretigny, à la WorldCon.
Elles ont récemment publié aux éditions Cambourakis L’Exoplanète Féministe de Joanna Russ qui regroupe des essais traduits et choisies.
Clara Pacotte est autrice, vidéaste et éditrice. Dans son travail artistique, elle explore des alternatives sociales émancipatrices en alliant archive et fiction. Elle a créé en 2020 les éditions RAG. Récemment elle a coécrit Le Jukebox des trobairitz.
Charlotte Houette est peintre et membre fondatrice du collectif TCU au sein duquel elle a organisé plusieurs ateliers d’écriture et d’édition.

Rieul Techer Ingénieur-chercheur en énergie et environnement de formation, déformé notamment par des pratiques de communs au sein de laboratoires citoyens visant à mettre au travail des formes de recherche hors les murs, situées et engagées, je travaille des dispositifs de bifurcations (énergétiques) par ce qu’on pourrait appeler des formes de design en milieux énergétiques – par l’enquête (entendue comme attitude et non comme méthode) et la recherche. Mes travaux du moment portent sur une histoire de la futurologie énergétique au prisme des aspects de modélisations, de représentations et de récits. Ils visent notamment à révéler les héritages (socio-techniques) qui permettent et empêchent des formes de futurs énergétiques d’avenir, par le regard de l’écologie critique (rapports de genres, de classes et de colonialité).

Fanny Lopez est historienne de l’architecture et des techniques (doctorat Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Professeure HDR à l’ENSA Paris-Malaquais et co-directrice du LIAT. Ses activités de recherche et d’enseignement portent sur l’impact spatial, territorial et environnemental des infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que sur les imaginaires techniques associés. Ses ouvrages : Le rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique (Ed. La Villette, 2014, traduit chez Manchester University Press, 2021) ; Les territoires de l’autonomie énergétique: espaces, échelles et politiques (Iste et Wiley 2019), L’ordre électrique, infrastructures énergétiques et territoires (Ed.Métis Presses2019), À bout de flux (Ed. Divergences, 2022), Le feu numérique : spatialité et énergie des data centers (Ed.Métis Presses2023). Prix 2011 de la thèse sur la ville (Aperau, Certu, Puca, SFU), Prix 2021 de l’Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l’énergie. En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.

Marion Emery est architecte. Doctorante au LIAT en parallèle de sa pratique d’architecte et urbaniste, elle rédige une thèse en architecture sous la direction de Dominique Rouillard. Intitulée « Et si on recouvrait Paris d’une dalle béton » Traverser Paris par l’autoroute : mobilisations, contestations, alternatives (1956-1976), sa recherche s’attache à analyser les projets d’autoroutes urbaines parisiennes successivement contestés puis abandonnés, de la fin des années 50 au milieu des années 70. Elle est également maîtresse de conférences associée à l’Ensa Paris-Malaquais.

Roman Sole Pomies a récemment terminé une thèse au Centre de sociologie de l’innovation sur la gestion patrimoniale des voiries dans les petites collectivités. Ses travaux interrogent la place des activités de maintenance dans les politiques publiques, autour d’une réflexion sur les liens entre la gestion des infrastructures et les conceptions de l’environnement.

Caroline Gallez est directrice de recherche à l’Université Gustave Eiffel, au sein du Laboratoire Ville Mobilité Transport. Elle analyse les dimensions politiques des transformations sociales, territoriales et techniques des systèmes de mobilité et des systèmes énergétiques face aux urgences environnementales. Elle s’intéresse aux inégalités, aux rapports sociaux (de classe, de genre, de race) et aux enjeux de justice associés aux régulations de la mobilité et de l’énergie en contexte d’urgence environnementale. En 2023, elle a coordonné avec Olivier Coutard un ouvrage collectif sur les dynamiques de transition énergétique en Ile-de-France (l’Œil d’Or). Elle est membre du comité d’orientation et de prospective du Forum Vies Mobiles (https://forumviesmobiles.org/).

Ketty Steward est poétesse, essayiste et autrice de textes fantastiques et de science-fiction. Elle préside l’association Réseau Université de la Pluralité qui s’intéresse aux imaginaires alternatifs du futur. Psychologue clinicienne et docteure en psychologie (Paris 8- LPPC), elle travaille sur la place du récit dans le soin.

Utopiste des grands chemins, philosophe, diplômée de lettres modernes et docteure en philosophie politique, Alice Carabédian travaille à une reconceptualisation de l’utopie politique au sein de la science-fiction contemporaine. Ses recherches polymorphes tissent des liens avec des artistes, chercheurs, auteurs, militants. Elle a publié Utopie radicale, Par-delà l’imaginaire des cabanes et des ruines (Le Seuil, 2022), Prix Essai du festival L’Ouest hurlant (2023) et finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire (2023). En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques
(à Mellionnec) : La machine dans le jardin.

Anaël Marrec est historienne des techniques. Elle travaille sur les
solutions et les promesses technologiques récurrentes de l’ère industrielle dans le domaine de l’énergie, de l’énergie marémotrice à la méthanisation en passant par le nucléaire. En se penchant sur les conflits et problèmes environnementaux qu’il ont mis en jeu, elle examine l’évolution des modèles socio-techniques promus comme
alternatives.

Après avoir étudié la philosophie contemporaine à l’Université Lyon III où il a travaillé à une critique du projet cybernétique, Victor Cachard s’intéresse à présent au rapport entre travail et technique à travers l’histoire des résistances populaires. Il est l’auteur d’une Histoire du sabotage en deux tomes publiée aux Éditions Libre, T.1, 2022 & T.2, à paraître. Il est également le coordinateur de l’ouvrage, Émile Pouget et la révolution par le sabotage, Éditions Libre, 2022. Installé en Haute-Loire, il fait vivre une petite librairie récemment renommée Librairie du Sabot.

“Je ne lis pas pour passer le temps, je lis pour prendre le temps, le faire mien, le comprendre”. Martine Laval est journaliste littéraire, grand reporter, blogueuse (« Lectures buissonnières »), métiers qu’elle a exercés une trentaine d’années pour Télérama. Elle écrit aujourd’hui pour Le Matricule des Anges et Siné Mensuel. Elle conçoit la programmation de Lettres du monde, festival de littérature étrangère à Bordeaux/Nouvelle-Aquitaine. Elle a créé au sein des éditions Le Sonneur la collection « Ce que la vie signifie pour moi » titre « emprunté »… à Jack London. Avec une seule passion : faire découvrir des écrivains, des univers, partager ses émois, ses rages, ses bonheurs de lectrice, et donner à tous l’envie de s’aventurer parmi les livres. Elle a publié : On s’est rencontrés simplement (Le Reflet, 2003), et Quinze kilomètre trois, aux éditions Liana Levi (2011), adapté pour le cinéma par Stéphane Mercurio.

Denys Moreau, est né en 1986 en Normandie. Il apprend à dessiner en cours de biologie, principalement dans les marges. Après avoir travaillé durant quelques années dans l’agriculture, et planté quelques milliers de pieds d’épinards en vallée de Seine, il se consacre au dessin et à l’illustration. Régulièrement, il auto-édite des petites histoires avec les Éditions de la sieste (leseditionsdelasieste.com), collabore avec le site de littérature Les cahiers du bruit et dessine pour la Confédération Paysanne. Son site web : denysmoreau.com

Juliette est professeure des écoles dans une classe multi-niveaux d’une école rurale. Elle utilise une presse typographique avec des élèves de 5 à 8 ans. Quelques années de maraîchage et une pratique assidue de la couture lui ont appris à aimer les techniques simples et le temps qu’elles prennent.

Après des études de lettres, de cinéma et de mise en oeuvre de projet culturel, Élise Feltgen devient libraire, à Rouen, puis à la librairie Le Temps qu’il fait à Mellionnec. Après une incursion dans l’édition (La Robe noire), elle participe également à la rédaction du site Les cahiers du Bruit, et du fanzine CommunE Ouragan. En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.
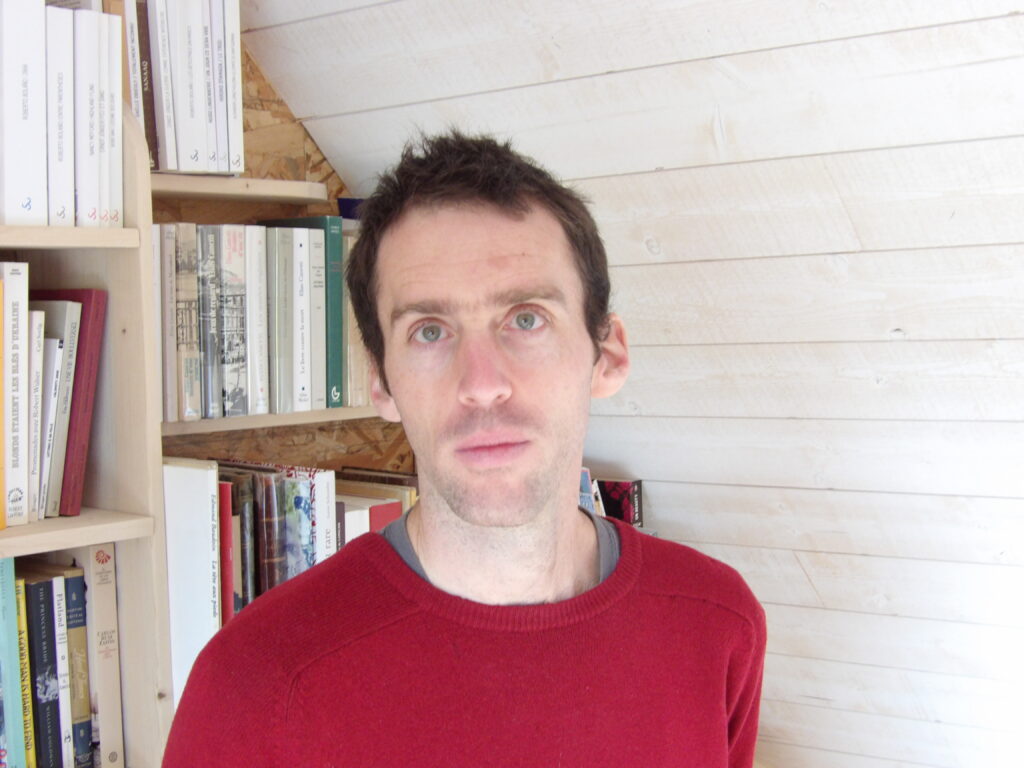
Après des études d’anglais et de philosophie politique, Robin Kerguillec devient libraire à Rouen, puis à la librairie Le Temps qu’il fait à Mellionnec. Après une incursion dans l’édition (La Robe noire), il participe également à la rédaction du site Les cahiers du Bruit, et du fanzine CommunE Ouragan. En 2023 il co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.
2023
Un très grand merci à Étienne Cabaret pour la sonorisation, la captation et le montage des différentes interventions. Vous pouvez ici les écouter ou les réécouter à loisir.
Table ronde
“Réparation, maintenance, démantèlement des infrastructures”

Conférence de Cara New Daggett
“Masculinités renouvelables”

Table ronde :
Une culture féministe de la technique

L’atelier techno utopique Bienvenue à bord



Les intervenant·es
et l’équipe de l’édition 2023

Paul Landauer est architecte, HDR, professeur à l’École d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est, où il dirige la filière de master « Transformation ». Il est également directeur du laboratoire OCS-AUSser (UMR CNRS 3329). Il est notamment l’auteur de L’architecte, la ville et la sécurité (PUF, 2009), L’invention du grand ensemble (Picard, 2010) et Émile Aillaud (Éditions du Patrimoine, 2011, avec Dominique Lefrançois). Ses recherches portent actuellement sur la réparation, la ruine et l’architecture du stock. Il prépare la publication de deux ouvrages : Les architectures de la réparation et Le grenier et la tombe. Il est par ailleurs associé de l’atelier d’architecture Füzesséry-Landauer.

Frédérique Mocquet est architecte, docteure en architecture, urbanisme et aménagement et maîtresse de conférences à l’École d’architecture de la ville et des territoires Paris-Est. Elle est membre permanent de l’OCS AUSser (UMR 3329 du CNRS) et membre associée du LLSETI (axe Humanités environnementales) de l’Université Savoie Mont-Blanc. Elle participe avec ce laboratoire à la chaire MIRE (Montagne Infrastructure Risques Environnement). Ses travaux en histoire de l’aménagement, aux interactions des disciplines de l’espace, des études visuelles et de l’histoire environnementale, portent notamment sur les représentations photographiques du paysage et les rôles que celles-ci jouent dans les politiques publiques et les projets d’aménagement du territoire.

Fanny Lopez est historienne de l’architecture et des techniques (doctorat Université Paris I Panthéon-Sorbonne), Professeure HDR à l’ENSA Paris-Malaquais et co-directrice du LIAT. Ses activités de recherche et d’enseignement portent sur l’impact spatial, territorial et environnemental des infrastructures énergétiques et numériques, ainsi que sur les imaginaires techniques associés. Ses ouvrages : Le rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique (Ed. La Villette, 2014, traduit chez Manchester University Press, 2021) ; Les territoires de l’autonomie énergétique: espaces, échelles et politiques (Iste et Wiley 2019), L’ordre électrique, infrastructures énergétiques et territoires (Ed.Métis Presses2019), À bout de flux (Ed. Divergences, 2022), Le feu numérique : spatialité et énergie des data centers (Ed.Métis Presses2023). Prix 2011 de la thèse sur la ville (Aperau, Certu, Puca, SFU), Prix 2021 de l’Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l’énergie. En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.
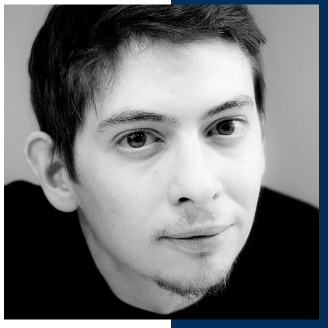
Alexandre Monnin est enseignant-chercheur, directeur scientifique d’Origens Medialab et directeur du MSc “Strategy & Design for the Anthropocene” (ESC Clermont BS x Strate Ecole de Design Lyon). Auteur d’une thèse sur la philosophie du Web, passé par l’Institut de recherche et d’Innovation du Centre Pompidou, ancien chercheur chez Inria et initiateur du DBpedia francophone, il a travaillé une quinzaine d’années dans le numérique. Depuis 7 ans, il réfléchit aux enjeux de la redirection écologique, un courant qu’il a co-initié avec Emmanuel Bonnet et Diego Landivar. Il a récemment co-écrit Héritage et Fermeture (avec E. Bonnet et D. Landivar, Divergences, 2021), co-édité Ecologie du Smartphone (avec Laurence Allard et Nicolas Nova, Le Bord de l’Eau, 2022), ainsi que Politiser le renoncement (Divergences, 2023).

Cara New Daggett est professeure en sciences politiques à l’université Virginia Tech, où elle travaille sur l’écologie politique féministe. Elle s’intéresse en particulier à la politique de l’énergie à l’ère des bouleversements planétaires.Elle a publié Pétromasculinité. Du mythe fossile patriarcal aux systèmes énergétiques féministes (Wildproject, 2023).

Diplômée en cinéma (Université de Saint Denis – Paris 8 ; la FEMIS), en théâtre (Conservatoire de Paris, XX), et en médiation culturelle (Université d’Aix-Marseille), Oona Spengler construit un parcours au croisement de plusieurs disciplines. Elle est réalisatrice de documentaires, sous toutes les formes : film, installation, radio, livre. Elle enseigne le documentaire à l’Université de Brest (UBO), et à l’INSEAC (Institut National Supérieur d’Education Artistique et Culturelle). Elle accompagne des créations collectives – elle intervient en milieux pénitentiaire, psychiatrique, médico-social, auprès de demandeur.deuse.s d’asile et dans les établissements scolaires. Elle travaille aussi comme comédienne, et fait entendre des textes littéraires par la lecture à voix haute (en festivals, à la radio, en bibliothèque). Elle est également traductrice et a notamment traduit Kae Tempest en français.
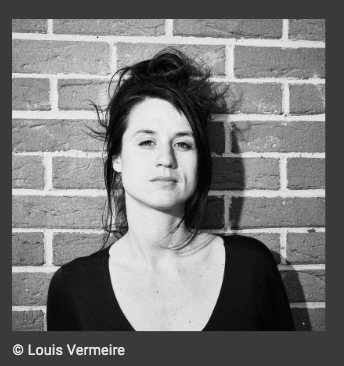
Jeanne Guien est docteure en philosophie et chercheuse indépendante. Elle consacre ses recherches à l’histoire de la société de consommation et de l’obsolescence. Elle conduit également des expériences de recherche-action concernant les biffins (récupérateurs de rue en Ile-de-France), le freeganisme (récupération alimentaire), la collecte municipale des déchets. Elle anime également une émission radio et un blog sur Médiapart afin de médiatiser certains enjeux sociaux et politiques liés au déchet : condition de travail des éboueurs et des biffins, politiques d’ « économie circulaire », injustices environnementales en France, répartition inégale de l’étiquette « écologiste » dans les luttes et les mouvements sociaux. Elle a récemment publié Le consumérisme à travers ses objets (2021) et Une histoire des produits menstruels (2023) aux éditions Divergences.

Utopiste des grands chemins, philosophe, diplômée de lettres modernes et docteure en philosophie politique, Alice Carabédian travaille à une reconceptualisation de l’utopie politique au sein de la science-fiction contemporaine. Ses recherches polymorphes tissent des liens avec des artistes, chercheurs, auteurs, militants. Elle a publié Utopie radicale, Par-delà l’imaginaire des cabanes et des ruines (Le Seuil, 2022), Prix Essai du festival L’Ouest hurlant (2023) et finaliste du Grand Prix de l’Imaginaire (2023). En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.

Isabelle Cambourakis, enseignante, éditrice et chercheuse indépendante, travaille depuis 2010 sur la sociohistoire des luttes et des mouvements sociaux et a publié plusieurs articles consacrés aux liens entre écologie et féminisme dans les années 1970 et 1980 en France.
Elle a créé en 2015 la collection féministe « Sorcières » aux éditions Cambourakis.
Elle a notamment co-écrit Retour à la Hague. Féminisme et nucléaire avec Xavière Gauthier et Sophie Houdart.

Denys Moreau, est né en 1986 en Normandie. Il apprend à dessiner en cours de biologie, principalement dans les marges. Après avoir travaillé durant quelques années dans l’agriculture, et planté quelques milliers de pieds d’épinards en vallée de Seine, il se consacre au dessin et à l’illustration. Régulièrement, il auto-édite des petites histoires avec les Éditions de la sieste (leseditionsdelasieste.com), collabore avec le site de littérature Les cahiers du bruit et dessine pour la Confédération Paysanne. Son site web : denysmoreau.com

Juliette est professeure des écoles dans une classe multi-niveaux d’une école rurale. Elle utilise une presse typographique avec des élèves de 5 à 8 ans. Quelques années de maraîchage et une pratique assidue de la couture lui ont appris à aimer les techniques simples et le temps qu’elles prennent.

Après des études de lettres, de cinéma et de mise en oeuvre de projet culturel, Élise Feltgen devient libraire, à Rouen, puis à la librairie Le Temps qu’il fait à Mellionnec. Après une incursion dans l’édition (La Robe noire), elle participe également à la rédaction du site Les cahiers du Bruit, et du fanzine CommunE Ouragan. En 2023 elle co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.
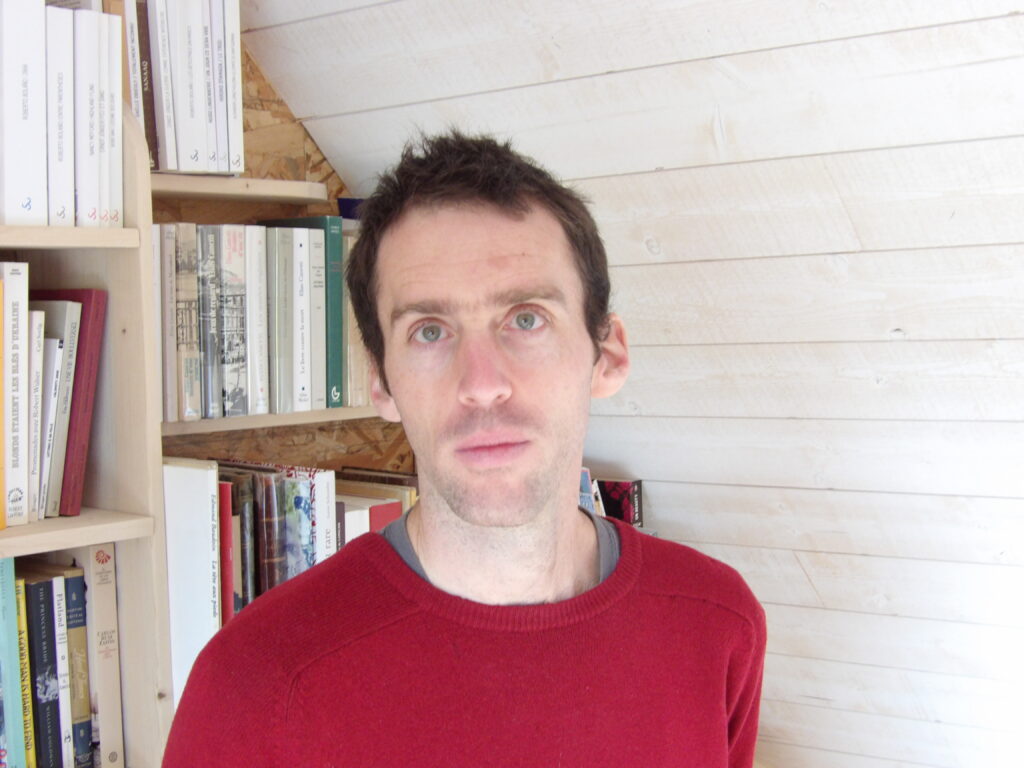
Après des études d’anglais et de philosophie politique, Robin Kerguillec devient libraire à Rouen, puis à la librairie Le Temps qu’il fait à Mellionnec. Après une incursion dans l’édition (La Robe noire), il participe également à la rédaction du site Les cahiers du Bruit, et du fanzine CommunE Ouragan. En 2023 il co-crée et co-dirige le festival sur les imaginaires techniques (à Mellionnec) : La machine dans le jardin.